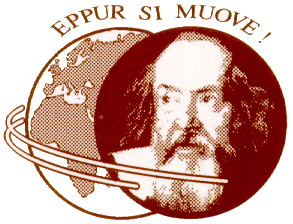 Planification des
réseaux GSM et évolution vers les systèmes de troisième
génération
Planification des
réseaux GSM et évolution vers les systèmes de troisième
génération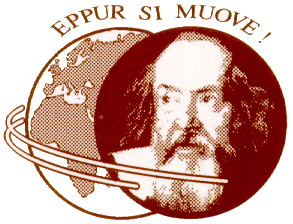 Planification des
réseaux GSM et évolution vers les systèmes de troisième
génération
Planification des
réseaux GSM et évolution vers les systèmes de troisième
génération
Frédéric MENOT
Filière Réseaux &Télécommunications
Option radiocommunications avec les mobiles
Année scolaire 1999-2000
Remerciements
Je tiens à remercier toute l’équipe du département ingénierie qui m’a permis de m’intégrer rapidement dans le service, et dont les nombreux conseils m’ont permis de mener à bien ce projet.
Mes remerciements vont aussi à des personnes en dehors du département où je travaillais qui m’ont consacrer un peu de leur temps pour m’expliquer et me conseiller sur les méthodes à tenir, les moyens d’y parvenir, je pense en particulier à Jean Michel Pintaux pour son aide sur les comparatifs au niveau des modèles de propagation.
Introduction * I Présentation de la société * II Analyse des besoins – Syhthèse du cahier des charges * II.1. Analyse des besoins * II.1.a. Considérations générales * II.1.b. Besoins dans le cadre des faisceaux hertziens * II.1.c. Besoins dans le cadre des réseaux cellulaires de type GSM * II.1.d. Besoins dans le cadre des réseaux cellulaire de type GPRS et UMTS * II.2. Synthèse du cahier des charges * |
III Evaluation technique * III.1. Introduction * III.2. ATOLL (Forsk) * III.3. ICS Telecom (ATDI) * III.4. SYRADIF (Syradel) * III.5. ASSET (Aircom pas l’intermédiaire de Net2S) * III.6. ELLIPSE (CRIL Technologie) * III.7. Prestataire Net2S * III.8. Données cartographiques – USGS * III.9. Données cartographiques – SPOT Image * III.10. Données cartographiques – ISTAR * III.11. Données cartographiques – IGN * |
IV Evaluation financière * IV.1. Introduction * IV.2. ATOLL (Forsk) * IV.3. ICS Telecom (ATDI) * IV.4. SYRADIF (Syradel) * IV.5. ASSET (Aircom par l’intermédiaire de Net2S) * IV.6. ELLIPSE (CRIL Technologie) * IV.7. Prestataire Net2S * IV.8. Données cartographiques – USGS * IV.9. Données cartographiques – SPOT Image * IV.10. Données cartographiques – ISTAR * IV.11. Données cartographiques – IGN * |
V Comparatif * Conclusion * |
Annexe * Annexe : Résumé des différentes techniques de radiocommunication * Introduction * I. GSM * II. GSM 14.4kbps * III. HSCSD * |
IV. GPRS * V. EDGE * VI. W-CDMA * VII. UMTS * VIII. Récapitulatif * |
Parmi ses nombreuses activités, le groupe Sagem sa s'occupe de la mise en œuvre de réseaux hertziens. Son offre complète couvre des bandes de fréquence jusqu'à 38GHz et des débits jusqu'à 16x2Mbits/s, dans des configurations de réseaux variées :
Dans ces différentes activités, il est nécessaire, pour répondre aux appels d'offres aussi bien que pour déployer un réseau, de disposer d'outils de simulation permettant d'implanter des bases, de visualiser la couverture et d'afficher les besoins en ressources radio pour écouler le trafic,...
A mon arrivée la Sagem disposait d'outils développés de façon interne, fonctionnant très bien dans le cadre d'applications point à point et point - multipoint mais non adaptées aux nouvelles demandes.
Le sujet de ce stage de fin d'études est centré sur la planification des réseaux GSM et leur évolution vers les systèmes de troisième génération. Il s'agit d'évaluer différents outils de couverture radio disponibles sur le marché et de comparer leurs performances, dans le but d'acquérir un logiciel de dimensionnement polyvalent assurant les besoins actuels de couverture point à point et de réseau cellulaire ainsi que des applications à venir : couverture indoor, boucle locale radio et réseau UMTS.
Nous allons commencer par rappeler quelques informations sur la structure et les activités du groupe Sagem Sa.
Puis nous aborderons la synthèse du cahier des charges ainsi que les différentes étapes qui ont mené à son élaboration.
Enfin nous présenterons l'étude en vue du choix d'un de ces logiciels. Elle se décompose en deux étapes pour chaque logiciel :
On remarquera en annexe, un document qui a été le premier travail réalisé dans le cadre du stage sur les différentes technologies de radiocommunication avec les mobiles.
Le Groupe SAGEM est un groupe de haute technologie aux assises internationales qui, avec un chiffre d'affaires consolidé de 22,4 milliards de francs pour l’année 1999, réalisé pour 46,3% à l’international, emploie 15 600 personnes, dont 7 300 cadres et techniciens.
Deuxième groupe français de télécommunications, troisième groupe européen en électronique de défense et de sécurité, SAGEM est aussi un des leaders de l’électronique automobile. SAGEM est implanté dans plus de vingt pays et possède des centres de fabrication en Allemagne, au Brésil, en Espagne, aux Etats-Unis et en République Tchèque.
Sur les dix dernières années, le chiffre d’affaires est passé de 10,4 (1989) à 22,4 (1999) milliards de Francs (x 2,15), le résultat net part du groupe de 151 (1989) à 962 (1999) millions de Francs (x 6,4) et la capitalisation boursière à fin 1999 s’élève à 42,4 milliards de Francs (x 17.7 depuis fin 1989).
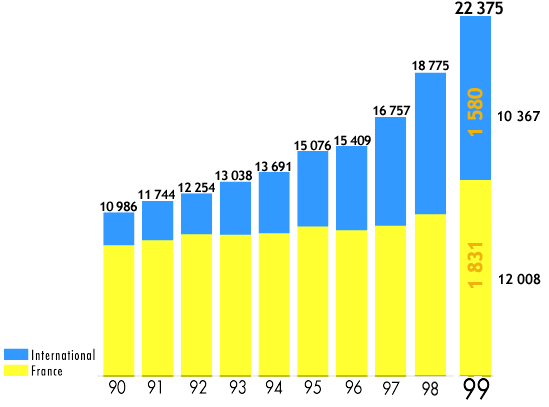
Les activités se répartissent en trois branches, à savoir :

Organigramme de Sagem Sa
Comme on peut le voir sur l’organigramme de la page précédente, la branche Communications est divisée en plusieurs divisions :
Division Téléphones Mobiles
Gamme GSM, DCS...
Gamme GSM, DCS, PCS...
PDA communicants,
Modules GPRS...
(SCS SAGEM)
Division Internet et Réseaux
Réseaux d'entreprises et accès Internet, Réseaux Internet et optique
Systèmes de radiocommunication (GSM R, boucle locale radio), Infrastructures de radiocommunication (équipements de réseaux mobiles, faisceaux hertziens) et Signalisation
F@x™ Internet, DECT et produits d'accès (pour réseaux Internet, Intranet, câble, XDSL, RNIS...)
Télévision numérique (décodeurs)
Mon stage s’est déroulé au sein de la branche Communications, division Internet et Réseaux, activité Réseaux de Radiocommunications, au sein du département Faisceaux Hertziens.
Comité Exécutif |
mise à jour : 24/01/2000
Pierre FAURRE |
Président-Directeur Général | |
Mario COLAIACOVO |
Directeur Général, Directeur Administratif et Financier | |
Guy ROUANNE |
Directeur Général, Directeur de la Division Téléphones Mobiles | |
Jean-Paul THIERRY |
Directeur Adjoint de la Division Téléphones Mobiles | |
Georges PENALVER |
Directeur de la Division Internet et Réseaux | |
Marc MATHIEU |
Directeur Commercial de la Branche Communications | |
Jacques PACCARD |
Directeur de la Division Défense et Sécurité | |
Nicolas DONJON |
Directeur de la Division Automobile | |
Armand DUPUY |
Directeur des Recherches et Développements | |
Patrick SEVIAN |
Directeur des Fabrications | |
Comité de Direction |
||
mise à jour : 24/01/2000
Le Comité de Direction comprend, en plus des membres du Comité Exécutif :
Michel TOUSSAN |
Directeur Général Adjoint, Directeur de la Division Câbles | |
Xavier LAGARDE |
Directeur du Personnel et des Relations Sociales | |
François PARDOUX |
Directeur des Achats | |
Francis GAILLARD |
Directeur du Contrôle Financier | |
Georges LABARRE |
Directeur du Développement et de la Diversification | |
Gilles CUBIER |
Directeur Qualité et Environnement | |
Romain WALLER |
Directeur du Département Mobiles Europe | |
Charles AB-DER-HALDEN |
Directeur de l'Activité Réseaux Professionnels et Internet | |
Thierry BUFFENOIR |
Directeur de l'Activité Réseaux de Radiocommunication | |
Bernard CASTAN |
Directeur de l'Activité Terminaux Internet | |
Philippe VIDAL |
Directeur de l'Activité Audiovisuel et Internet | |
Jean-Paul JAINSKY |
Directeur de l'Activité Sécurité | |
Henri TRINTIGNAC |
Directeur de l'Activité Contrôle Moteur |
II Analyse des besoins – Syhthèse du cahier des charges
La première étape de ce stage a été de reprendre les différentes connaissances en radio acquises lors de mon cursus et de les aborder d'un point de vue très pratique afin de savoir quels éléments sont nécessaires dans un logiciel pour pouvoir répondre aux mieux aux besoins réels de déploiement et de planification d'un réseau de faisceaux hertziens ou cellulaire.
Dans une liaison hertzienne certains éléments sont particulièrement intéressants pour rendre compte de l'état du bilan de liaison. La figure ci dessous représente le synoptique de la partie qui nous intéresse :
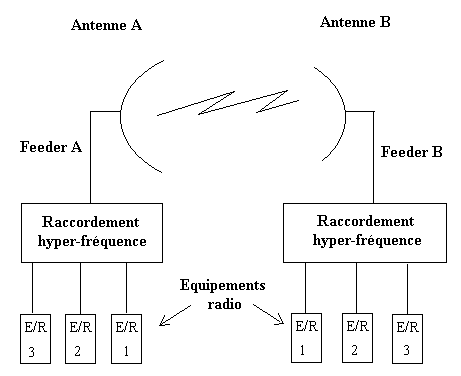
La zone de raccordement hyper-fréquence est détaillée dans la figure ci-dessous :
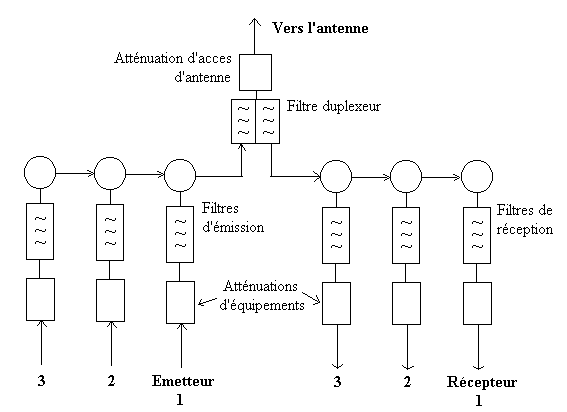
Une première chose que l'on peut remarquer sur la configuration des équipements (figure précédente) est que les pertes de branchements en émission et en réception sont différentes selon le canal considéré, cela étant du au nombre différent d'éléments à traverser avant de parvenir au filtre final.
Ces éléments qui font apparaître, comme nous le verrons plus loin, des atténuation de plusieurs dB ne peuvent pas être négligées et doivent donc pouvoir être saisies lors de l'implantation d'un site ou d'une liaison.
Le bilan de liaison dont nous avons précédemment parlé sera donc calculé de la sorte :
Puissance d'émission paramètre caractéristique de l'émetteur
- Pertes branchement émission pertes dues au filtrage hyperfréquence émission
- Pertes feeder émission pertes dans le guide d'onde de liaison émetteur - antenne
+ Gain antenne émission
- Affaiblissement d'espace libre propagation de l'onde électromagnétique dans l'air
+ Gain antenne réception
- Pertes feeder réception pertes de liaison antenne - récepteur
- Pertes branchement réception pertes dues au filtrage hyperfréquence réception
= Niveau nominal reçu
Le récepteur est caractérisé par son seuil de réception pour un taux d'erreurs donné. C'est par définition le niveau de réception à partir duquel on obtiendra le taux d'erreur.
La différence entre le niveau reçu et le seuil donne la marge de fonctionnement de la liaison qui permettra d'obtenir la qualité voulue une fois les paramètres difficilement simulables en place : conditions de propagation non constantes dans le temps et dans l'espace, variations des conditions climatiques, perturbateurs,..
On comprends ainsi que le logiciel qui permettra d'incorporer le plus grand nombre de paramètres permettra d'avoir des marges de fonctionnement les plus faibles et utiliser ainsi au mieux les équipements.
Particulièrement dans le cas des liaisons par faisceaux hertziens, les perturbateurs doivent être pris en compte. Ils correspondent à tous les signaux parasites autres que le signal utile en provenance de l'émetteur en regard.
La somme de tous ces bruits donne le niveau de perturbation résultant. Le calcul du niveau d'un perturbateur s'effectue suivant le même principe que celui du niveau nominal de réception.
- Pertes branchement émission pertes dues au filtrage hyperfréquence émission
- Pertes feeder émission pertes dans le guide d'onde de liaison émetteur - antenne
+ Gain antenne émission
- Découplage angulaire
- Découplage de polarisation
- Affaiblissement d'espace libre propagation de l'onde électromagnétique dans l'air
+ Gain antenne réception
- Découplage angulaire
- Découplage de polarisation
- Pertes feeder réception pertes de liaison antenne - récepteur
- Pertes branchement réception pertes dues au filtrage hyperfréquence réception
- Affaiblissement spectral
= Niveau du perturbateur
Dans ce calcul apparaissent les pertes suivantes :
Si l'on répète ce calcul pour tous les éléments perturbateurs et que nous additionnons les résultats on obtient le perturbateur résultant. A ce niveau vient s'ajouter au bruit thermique nominal du récepteur pour donner le bruit apparent du récepteur.
Perturbateur résultant : ![]()
Niveau de bruit apparent : ![]()
Seuil apparent : ![]()
Marge théorique : ![]()
Seuil nominal à 10-6 : -80dB
Niveau nominal reçu : -50dB
Perturbateur résultant : -90dB
Bruit thermique : -95dB
Rapport S/N à 10-6 : +15dB
Ainsi Nbra = -88.8dB
Sa = -88.8 + 15 = -73.8dB et M = -50 + 73.8 = 23.8dB
Sans perturbateur on aurait eu :
M = -50 - (-80) = 30dB
La marge s'est donc dégradée de 6.2dB du au fait de la présence des perturbateurs.
Lorsque la marge s'avère trop faible il faut changer des caractéristiques du réseau : modification du plan de fréquence, choix d'antennes plus directives,..
Un logiciel qui répondrait aux attentes pour les faisceaux hertziens devrait donc renseigner, au moins, les différentes informations ci-dessous.
Puissance d'émission
Seuil de réception à 10-3, 10-6
Perte de branchement émission (suivant le rang du canal)
Perte de branchement réception (suivant le rang du canal)
Gain nominal
Affaiblissement en s'écartant de l'axe : diagrammes polaires et contra-polaires
Atténuation en dB/m
D’autres éléments pourraient être intéressants comme la gestion des relais passifs dos à dos ainsi que des réflecteurs plan utilisé comme relais passifs.
Les principales fonctions nécessaires pour les FH, sont l’affichage de bilan de liaison ainsi qu’une gestion assez fine des phénomènes d’interférences.
On peut aussi penser à des fonctions de recherche de site liées à la visibilité par rapport à un autre point ou par rapport à la hauteur du sursol, à des fonctions d’optimisation de la hauteur des antennes de façon à minimiser celles ci en maintenant une liaison dont le 1er ellipsoïde de Fresnel se dégagé de x%.
Enfin pour la BLR, une gestion des sites d’abonné est intéressante afin de voir comment écouler le trafic désiré.
A ces différentes fonctions, il serait utile de rajouter la possibilité de créer un réseau sans avoir de modèle de terrain et la possibilité de dresser soi même un profil de terrain à partir de cartes IGN par exemple. En effet acquérir un modèle de terrain pour répondre de façon approximative à un appel d’offre sur de la boucle locale radio peut s’avérer peu rentable surtout si le réseau se trouve en plein milieu de l’Afrique…
La plupart des besoins ont été déjà exprimés dans la partie précédente, mais plusieurs fonctions sont à rajouter :
par exemple on définit une zone que l’on veut couvrir sous forme d’un polygone ou un chemin (autoroute,…) et le logiciel donne les sites susceptibles d’accueillir une BTS,
Rq : cette dernière fonction qui est loin d’être généralisée sera un plus non négligeable, permettant une mise en place des paramètres très rapide.
Par contre la prise en compte de toutes les pertes d’équipements n’est plus trop importante.
Enfin certains éditeurs parlent de fonctions très intéressantes d’optimisation sur le principe du " What if… " :
Comment faire pour insérer une stations (lieu et plan de fréquence) dans un réseau existant sans créer de perturbations ?
Où placer au mieux mes sites et combien en placer pour écouler le trafic donné ?
GPRS
La gestion du trafic devient ici un paramètre très important, qui sera indispensable en UMTS.
Aucun éditeur de logiciel n’est encore très clair sur ce point ; pour pouvoir simuler la charge du réseau il faudrait faire varier le trafic lors de période définies.
Un autre point important est la diversité des services : est ce que cette diversité sera intégrée de façon statistique dans la nature du trafic (alors qu’on a pas encore idée des proportions), ou est ce que l’on pourra faire varier ces services à son propre gré (ce qui donnerait dans ce cas une multitude de paramètres difficilement gérables).
En fait on touche ici plutôt au dimensionnement, mais pour être vraiment intéressant l’outil de couverture devra aussi être un outil de dimensionnement.
UMTS
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour l’UMTS :
Rq : si le contrôle de puissance est surtout présent sur la liaison montante, il existe aussi sur la liaison descendante.
L’UMTS et toutes ses implications sont encore difficiles à prévoir. Si la plupart des éditeurs sont en train de développer leur module, peu d’entre eux sont capables de donner des détails, et il y a fort à prévoir que les premiers modules seront assez légers et que l’évolution se fera au fur et à mesure de l’apparition des besoins chez les utilisateurs.
Il s'agit donc dans un premier temps de comparer les logiciels au niveau technique. Le principal problème qui apparaît est la base de référence sur laquelle on pourra faire des tests. La meilleure solution aurait été de disposer des mêmes modèles numériques de terrain pour chaque logiciel. Loin d'être aussi simple, les éditeurs de logiciel quand ils disposent de MNT en commun n'acceptent pas de rajouter les lieux désirés dans leur version d'évaluation.
L'évaluation est donc réalisée non pas sur les résultats obtenus, mais plutôt les critères suivants :
Dans la suite on va donc comparer cinq logiciels qui ont été choisis pour leur polyvalence, leur disponibilité et leur renommée.
Chaque nouvelle notion sera un peu plus détaillée qu'à l'occurrence suivante, ce qui implique une description du premier logiciel qui sera plus longue que les autres sans que cela ait de signification sur la qualité ou la complexité de chaque logiciel testé…
Suite à cette présentation des logiciels, on s’intéressera aux offres des prestataires de services en donnant leur réponse au cahier des charges établit précédemment.
Enfin, certains éditeurs de logiciels ne distribuent pas les modèles numériques de terrain, il est donc intéressant de trouver les distributeurs de données cartographiques, afin de comparer leur prestation.
Atoll est un logiciel de dimensionnement et de planification des réseaux cellulaires qui peut être utilisé sur tout le cycle de vie des réseaux : du design à l'expansion et l'optimisation.
Le logiciel exploite différentes données en entrée :
Quatre types différents de projets sont disponibles au démarrage : broadcast, WLL, GSM / DECT et PMR. On peut aussi créer son style de projet. Plusieurs projets peuvent être gérés simultanément.
L'écran d'Atoll est divisé en deux zones visibles simultanément, un espace de travail et une fenêtre d'explorateur. En plus de ces deux fenêtres ouvertes au démarrage, viennent s'ajouter en cours de session, les fenêtres "réception", "mesure",…
L'espace de travail affiche les cartes, les tableaux de caractéristique des données (format Excel) ou les rapports de couvertures.
La fenêtre réception permet l'affichage des profils et des champs reçus ou des interférences.
La fenêtre mesure permet l'affichage des mesures, et des valeurs de prédictions correspondantes.
La fenêtre légende permet d'afficher la légende des couvertures, mesures et clutter.
La fenêtre panoramique permet de visualiser l'environnement de la région étudié et de faire un zoom sur une région précise.
Différents éléments sont disponibles pour le déploiement d'un réseau. Les stations ou sites sont dans Atoll des équipements sur lesquels sont placés un ou plusieurs émetteurs équipés d'antennes aux caractéristiques particulières. Il est possible en affichant les propriétés d'une station de créer rapidement une station multi-sectorielle donc la création d'autres émetteurs sur le site.
Il est possible de créer des antennes et d'en paramétrer les caractéristiques pour chacune d'entre elles. Un grand nombre d'antennes est disponibles par défaut (plus de 300 antennes), avec le modèle et le constructeur. On remarquera quand même que nombre de ces antennes présentent des diagrammes très similaires, il faudra donc en créer d'autres pour une utilisation plus précise du logiciel. La création et le paramétrage est une opération longue, il a été prévu dans Atoll la possibilité de conserver dans un fichier que l'on ouvrirait à chaque nouveau déploiement, les caractéristique de toutes les antennes habituellement utilisées dans l'entreprise. Mise à part le diagramme, les données sont exploitables directement à partir d'un tableur.
L'orientation de chaque antennes est déterminée dans les propriétés de l'émetteur, mais elle peut aussi être ajustée directement sur la carte à l'aide de la souris.
Atoll offre aussi la possibilité de créer un modèle de site copiable et modifiable à volonté. (permet par exemple de créer un site tri-sectorielle de paramètres fixés et dont l'orientation sera défini lors de l'implantation)
Pour chaque site il est possible de visualiser la zone de visibilité (optique ou au sens du dégagement du premier ellipsoïde de Fresnel), ce qui est très appréciables pour voir rapidement les limites d'une cellule.
Les calculs de propagation sont effectués pour un ou plusieurs émetteurs sélectionnés par l'utilisateur, le pas du maillage utilisé est paramétrable ce qui permet de faire une première simulation grossière très rapide.
Les modèles de propagation suivants sont fournis en standard :
Les modèles Okumura Hata et Cost Hata, modèles statistiques particulièrement adaptés aux mobiles, ils permettent d'avoir plusieurs formules de propagation applicables selon l'environnement géographique (petite ou moyenne vile, centre ville,…). Ces modèles sont liés aux fichiers d'occupation de sursol qui contiennent pour chaque classe la hauteur associée.
Les données prises en compte par le calcul sont les positions et caractéristiques radioélectriques des émetteurs, les données géographiques (MNT, sursol, climat).
Après les calculs de propagation, les informations sont disponibles pour chaque station, par désignation d'un point sur le plan : de façon dynamique, il est possible de voir la valeur du champs reçu de la part des trois émetteurs les plus puissants, les affaiblissement dus à la diffraction, et on peut aussi disposer d'une représentation graphique du profil de terrain entre un émetteur et un point que l'on déplace sur le plan. Ce dernier point est particulièrement intéressant pour avoir une première idée des zones en visibilité, des zones ou l'affaiblissement sera trop fort,…
Remarque : l'affichage de trajet direct n'est possible qu'à partir d'un émetteur.
Les zones de couverture sont définies pour un émetteur ou globalement pour un réseau comme l'ensemble des points qui répondent à un ou plusieurs critères définis par l'utilisateur. Ces zones sont représentées dans le logiciel Atoll comme des calques.
Les différents critères disponibles sont :
Etude de couverture par émetteur ce qui équivaut à une comparaison par rapport à un seuil pour le champ reçu de l'émetteur par le récepteur ; l'option best serveur permet de représenter la zone où le champs reçu de la station est meilleur que celui reçu de tout autre station.
Etude de couverture par niveau de champ qui réalise une comparaison par rapport à plusieurs seuils (8 par défaut mais on peut en définir plus) pour le champs reçu de l'émetteur par le récepteur.
La zone représentée est celle où le champs reçu provient d'au moins deux émetteurs.
Il s'agit des zones d'interférences pour chaque station qui correspondent à une comparaison par rapport à un niveau de seuil de rapport signal à bruit spécifié par l'utilisateur. La zone de brouillage représentée correspond aux points où le rapport signal à bruit est inférieur au seuil spécifié.
Les critères de brouillage peuvent être combinés avec les critères de couverture (best server)
La possibilité de ne calculer que ce qui a changer depuis la dernière simulation permet d'améliorer sensiblement la vitesse de traitement lors des simulations. De plus il est possible de verrouiller certaines simulations et comme le modèle de propagation peut être défini séparément sur chaque émetteur, on pourra par exemple dans un même projet affiché des couvertures avec différents modèles de propagation adaptés aux différentes zones considérées.
L'allocation de fréquence est automatique pour le GSM, une option permet de calculer le nombre de canaux requis, en chaque émetteurs, pour couvrir le trafic désiré.
Lors des tests on a simulé l'implantation d'un réseau GSM avec 12 stations ainsi que 5 liaisons faisceaux hertziens autour de Nice.
Le calcul de couverture est relativement rapide puisque pour un pas de maille minimum de 20 mètres, la simulation (propagation + couverture + interférences) a été réalisée dans une durée variant entre 5 et 10 minutes suivant le modèle choisit.
L'allocation de fréquence pour les stations GSM a été réalisée en 35 minutes, ce qui est aussi rapide. Elle débouche sur de nombreux problèmes notamment de dimensionnement (du au fait que je n'ai pas mis suffisamment d'émetteurs pour assurer les besoins en trafic) et d'interférences. En sélectionnant les émetteurs posant problèmes on peut voir quel émetteur brouille, sur quel canal,…
Suite aux différentes prédictions il est possible d'exporter des rapports exploitables dans un tableurs donnant plusieurs informations paramétrables suivant la prédiction.
Pour les faisceaux hertziens, on peut afficher de façon dynamique en fonction d'un point sélectionné sur la carte de voir le niveau d'interférence en fonction des trois émetteurs les plus puissants.
Toujours pour les faisceaux hertziens, lorsqu'on affiche les paramètres de la liaison, on obtient une fenêtre où il est possible de modifié dynamique les hauteurs des émetteurs / récepteurs afin de trouver la valeur optimale pour dégager l'ellipsoïde de Fresnel à x%.
Il n'y a pas de gestion des handovers dans la version testée.
L'UMTS n'est pas encore géré mais il est en cours de développement, une version devrait être disponible fin juin.
ICS Telecom est un outil de planification et de dimensionnement des réseaux cellulaires.
Les différentes données en entrée sont :
ICS Telecom utilise un format propriétaire différent des données que l’on pourrait trouver sur les sites usuels de données cartographiques mais dispose de convertisseurs de la plupart des données disponibles.
Les données relatives au trafic sont contenues dans les paramètres relatifs aux clutters sous forme de besoin en Erlangs pour chaque type de clutter. Cette particularité peut être considérée comme un défaut : si on considère un immeuble d’habitation de 30 étages et un centre d’affaire du même nombre d’étages le clutter utilisé sera de l’urbain 30m bien que les besoins sont très différents. On pourrait toujours utiliser un autre clutter que l’on définirait mais le nombre de clutter utilisé…
L’écran est constitué d’un espace de travail qui prends la plupart de l’écran, d’une série de menus en haut de la fenêtre et d’un scertain nombre de commandes sur la gauche.
Les différentes menus comprennent entre autre :
Parmi les différentes commandes, on a :
Les différentes applications possibles sont :
La fenêtre de paramétrage des modèles de propagation est très complète, elle comprend :
Chaque stations contient de nombreux paramètres : location, hauteur, puissance, gains et pertes d’antennes, fréquences, canaux, données administratives…
Les antennes, câbles et feeders sont référencés dans des listes qui ne sont pas vraiment des bases de données mais qui sont accessibles par la commande base -> station (ou antenna,..).
Les antennes peuvent être saisies à partir d’une fenêtre ; il n’y a pas moyen de faire un copier-coller à partir d’un tableau de style Excel (format le plus souvent disponible) mais une option intéressante est l’interpolation : on peut rentrer des valeurs (en linéaire ou en dB) pour 0,15,60,110,120,180° puis faire une interpolation pour les angles non renseignés puis une symétrie. La saisie des diagrammes se fait avec une précision de 5° en polaire et 1° en contrapolaire. Dans la version de base de ICS Telecom, 1115 antennes Andrew sont disponibles, correspondant à la plupart des utilisations.
Différents types de simulations sont disponibles, on notera par exemple la couverture par niveaux de champs et la couverture Best Server Display. Le changement de puissance d’une station entraîne un changement automatique de la couverture (hausse ou baisse d’un certain nombre de dB), par contre un changement dans la position ou la direction de l’antenne nécessitera le re-calcul de la couverture. Si l’on ne veut pas tous re-calculer il faudra, à la main désactiver les sites qui ne nous intéresse pas ce qui peut être peu pratique pour un gros réseau (il n’existe pas de filtres qui permettrait une sélection partielle).
Lors des simulations on a réalisé la couverture d’une zone urbaine dense avec 9 BTS. Le calcul de couverture s’est réalisé en 5 minutes en considérant un modèle déterministe avec diffractions et réflexions sur le sol, ce qui est relativement rapide pour un résultat très fiable. L’assignation de fréquence s’et déroulée en 100 minutes, ce qui est plus long que pour d’autres logiciels mais pour un résultat très satisfaisant correspondant au critère demandé : moins de 1% de zones brouillées.
Le nombre de canaux et d’IT nécessaires pour écouler le trafic peut être calculé en fonction du GOS (Grade Of Service) désiré.
De nombreuses fonctions donnent en résultats un rapport au format texte dont le nom est toujours jtemp.txt ce qui a conduit plusieurs fois à écraser ce fichier lors d’une nouvelle simulation. D’autre part ce fichier étant de type texte, il n’est utilisable qu’après conversion au format tableau.
Le calcul d’interférences donne un rapport clair qui montre sur les sites ayant un problème et qui met en évidence les canaux brouillés ainsi que les perturbateurs (site + canal). Cette gestion claire permet une résolution simple et efficace des problèmes d’interférences tant au niveau des réseaux cellulaires qu’au niveau des liaisons point à point.
Sur l’espace de travail, l’affichage des stations BTS, FH ou relais est complétée par le diagramme utilisé ainsi que la direction de l’antenne. Ces données sont fixes et ne peuvent pas être modifiées directement. Les menus déroulants permettent d’accéder aux paramètres de ces sites, de tracer un profil vers un point quelconque ou vers une station précise, d’avoir une vue 3D, d’activer ou d’isoler une sites…
Ces deux dernières fonctions sont nécessaires si l’on veut utiliser différents modèles de propagation. En effet il n’est pas possible d’assigner un modèle par site, le modèle s’applique à toutes les stations actives. Pour des réseaux comportant un grand nombre de stations cela peut être assez gênant car long.
ASSET (Aircom pas l’intermédiaire de Net2S)
La société U.S. Geological Survey distribue des modèles numériques de terrain pour des résolutions diverses.
Plusieurs couches sont disponibles : altimétrie, sursol, cartes civiles, hydrographie,..
A partir des bases de données disponibles en libre accès sur le site de l’USGS, de nombreuses cartes sont disponibles. La résolution varie entre 30’’ d’arc (~1.1km) et 7,5’ d’arc (15,6km). Ces résolutions ne sont pas très intéressantes car trop peu fines dans le cadre d’application de télécommunication.
Le principal inconvénient de ces données est la limitation de la surface du globe couverte : seuls les Etats Unis, et l’Amérique centrale sont couverts.
Tableaux Excel
Résumé des différentes techniques de radiocommunication
Le document ci-dessous a été rédigé à mon arrivée à la Sagem, à la demande de mon tuteur. Celui-ci souhaitait disposer pour lui-même ainsi que pour les autres ingénieurs de la section ingénierie, d’un aperçu rapide des différentes techniques de communications avec les mobiles, et particulièrement sur les dernières technologies : GPRS, EDGE et l’UMTS. Ce résumé a été conçu en s’appuyant sur les cours qui avait été dispensés durant l’année scolaire ainsi que sur de nombreux renseignements collectés sur Internet.
Ce document rappelle de façon très résumée les différentes techniques de téléphonie cellulaire en Europe en partant du système de deuxième génération GSM, et allant jusqu'au système de troisième génération l'UMTS.
Après l'explication de ces différentes techniques on rappellera les principales caractéristiques dans un récapitulatif.
Le GSM est le standard pour les communications numériques le plus répandu. Système de deuxième génération, il offre aux utilisateurs la téléphonie vocale, le fax et la transmission (modérée) de données. Il s'agit d'un système cellulaire fondé sur l'accès multiple réparti en temps (TDMA).
La commutation est réalisé en mode circuit, on a donc pour chaque abonné utilisant le réseau un canal dédié. Le débit maximum est de 9.6kbps.
Deux bandes de fréquence sont utilisées en Europe:
Pour chaque porteuse on a 8 intervalles de temps qui correspondent à 8 communications possibles.
La modulation utilisée est la GMSK (Gaussian Modulation Shift Keying), on a un symbole pour un bit.
Le transfert automatique intercellulaire effectué par le biais du mobile qui choisit la BTS de puissance la plus élevée est de type hard handover : par remontée des infos sur les puissance reçues et en fonction de la disponibilité, la BSC coupe le lien radio avec la BTS courante et établit la connexion avec la BTS choisie. On a donc coupure du lien radio pendant un bref laps de temps.
On utilise une diversité de fréquence en utilisant des sauts de fréquences lents. La gestion est effectuée au niveau de la BSC.
Les services de données disponibles sont :
Il s'agit d'une évolution mineure de la norme GSM qui permet un débit plus important par Time Slot. Premier pas vers des débits plus élevés : 14.4kbps, il est disponible techniquement depuis 1998 mais le gain de débit négligeable (amélioration peu perceptible par l'utilisateur) fait que cette technique est actuellement peu répandue.
Fonctionnement :

Dans la technique 14.4kbps on a donc un poinçonnage plus important, il y a alors moins de bits corrigeables et la qualité du lien radio doit être meilleure sinon la zone de couverture est réduite.
La technique ne semble intéressante que pour les opérateurs qui veulent proposer le HSCSD.
La technique HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) permet l'utilisation simultanée de plusieurs Time Slot dans la limite de quatre.
On atteint ainsi un débit maximum de 57.6kbps (4 x 14.4)
Cette technique est disponible depuis la fin du premier semestre 1999 mais elle est peu répandu chez les opérateurs car il y a trop peu de temps entre le HSCSD et GPRS
Il s'agit du passage à la génération " 2,5 " de téléphonie cellulaire mais c'est aussi la véritable évolution. Le GPRS (General Packet Radio System) fonctionne à la fois en mode circuit et en mode paquet.
La connexion orientée paquet permet une optimisation des ressources en créant des connexions 'virtuelles' permanentes, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de partager le même canal. On élimine ainsi un important inconvénient du GSM qui bloque une ressource même si l'utilisateur n'envoie aucune donnée. Le médium n'est utilisé que pour la durée de temps où les données sont reçues ou envoyées.
Le GPRS est implanté sur le réseau GSM existant en utilisant les mêmes fréquences, les mêmes trames, seule l'architecture radio est modifiée sensiblement (cf. plus loin)
Quatre débits sont accessibles par Time Slot : CS-1 9.05kpbs, CS-2 13.4kbps, CS-3 15.6kbps, CS-4 21.4kbps. Les quatre débits se différencient par des niveaux de protection différents. On a donc un compromis entre débit et intégrité (pour CS-4 on a aucun codage convolutionnel pour protéger l'information).
La QoS est négociée appel par appel.
GPRS permet aussi l'utilisation simultanée de tout ou partie des Time Slot, on aboutit ainsi à un débit maximum théorique de 171kbps. En pratique on s'attend plutôt à une utilisation de 4 TS sur la voie descendante (56kbps) et 1 TS sur la voie montante (14.4kbps).
L'allocation de ressources peut être dissociée dans les deux sens car les débits sur les voies UL et DL seront, dans la pratique, différents.
La mise en parallèle des réseaux circuits et paquets implique deux principales modifications qui apparaissent après les BSC :
Fonctionnement :
On utilise les Time Slots libres (non utilisés pour des communications) pour y faire transiter des données. Par exemple si le réseau a un taux de congestion de 2%, on aura au moins un TS libre pour des données 98% du temps.
On a donc une gestion dynamique des TS afin d'utiliser en forte demande la totalité des TS de la cellule.
L'impact sur l'architecture réseau :
Le GPRS sera disponible à partir du deuxième semestre 2000, et va être mis en place par la plupart des opérateurs car l'implémentation est rapide et flexible, le coût d'investissement faible.
Le développement du GPRS est très lié au développement des applications WAP qui constitueront l'interface avec le Web.
Le GPRS va aussi permettre aussi au niveau professionnel l'accès à des réseaux privés intranets. Cela peut être réalisé grâce à une technologie qui allie confidentialité et authentification : les VPN (Virtual Private Network) qui permettent de créer une sorte de tunnel à travers les réseaux radios et IP. Un utilisateur pourra donc accéder à la totalité de ses informations à partir de son mobile sans avoir à passer par un ISP. En utilisant le lien radio essentiellement pour faire transiter des informations, ces utilisateurs utiliseront une quantité importante de ressources.
GPRS Phase 1
Dans cette première phase qui devrait être en place à la fin de l’été 2000, chaque utilisateur pourra utiliser 3 TS en DownLink et 1 en UpLink sauf pour quelques applications ou le maximum sera à 6 TS sur l’une ou l’autre des voies. Il n’y aura pas non plus de canal dédié au GPRS
Entre données circuits et données paquets on introduit la notion de territoire qui correspond à une suite de TS consécutifs :
CCCH |
TS |
TS |
TS |
TS |
TS |
TS |
TS |
TS |
TS |
TS |
TS |
TS |
TS |
TS |
TS |
En raison des changements de territoire, on va avoir une augmentation du nombre de handovers intracellulaires, ce qui va induire une augmentation de la signalisation.
La frontière entre ces deux territoire est dynamique en fonction de la charge de trafic et en considérant que les données circuits (dont la parole) sont prioritaires.
Modèles de simulation - trafic
Les simulations discrètes sont les seuls moyens pratiques d’observer les performances du GPRS ainsi que les comportements du réseau. En effet les blocages des données (en mode paquet) ont des effets sur les délais qui sont très difficile à estimer.
Le trafic GPRS ne suit pas une loi de Poisson (comme en GSM) mais est par nature une série de burst.
La taille des paquets n’est pas fixe, elle peut varier entre 256 et 512 bytes et peut être même moins pour des protocoles particulier comme le WAP. La distribution de la longueur de ces paquets étant loin d’être gaussienne (l’occurrence de paquets très grands est non négligeable), les mesures de trafic auront de grandes variations.
Rq : les variations de trafic étant grandes, il n’est pas possibles en mode paquet de garantir un débit minimum à l’utilisateur final.
Les sources de délais sont :
Gestion des handovers :
Il est difficile de parler de handover au sens du GSM, on parlera plutôt de resélection de cellule. Il existe 3 états : GMM_IDLE, GMM_STANDBY et GMM_READY.
Lors d’un état GMM_READY (le mobile n’a rien à transmettre), le mobile peut faire une mise à jour de cellule.
Les aires de location étant appelées des ‘Routing Area’, le mobile réalisera des ‘Routing Area Update’.
Signalisation :
Elle est identique au GSM, mais les paquets étant plus court que pour la parole comme on l’a vu précédemment, il y aura plus de tentative pour générer un Erlang (entre 15 et 30 fois plus) donc plus de signalisation :
30 Erl de trafic de type parole è 5% RACCH
1 Erl de trafic de type paquet è 5% RACCH
L'un des buts de EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), est de permettre des hauts débits sans avoir besoin d'une licence 3G dont on sait qu'elle seront limitées. Cette technique intéresse donc particulièrement les nouveaux entrants sur le marché.
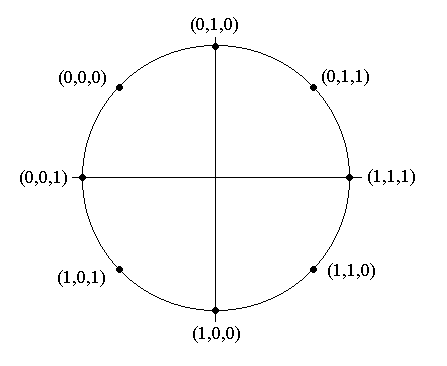
Il s'agit d'une nouvelle modulation la PSK (Phase Shift Keying) :
On a 8 états, la vitesse de modulation est la même que pour la GMSK mais permet un débit instantané trois fois plus élevé, chaque état de modulation transmettant l'information relative à trois bits. Etant donné que l'on a plus d'états on est aussi plus sensible au bruit ce qui est l'inconvénient de ce type de modulation.
Ajouté à cette modulation, EDGE réalise une rotation de
phase de ![]() d'un
symbole à l'autre, on a donc 'virtuellement' 16 états
accessibles.
d'un
symbole à l'autre, on a donc 'virtuellement' 16 états
accessibles.
La forme des burst ne change pas :
3 |
58 |
26 |
58 |
3 |
tail données apprentissage données tail
La séquence d'apprentissage est très importante car elle contient des déphasages différents pour EDGE et pour le GSM, et en analysant cette séquence le récepteur peut déterminer quelle modulation a été utilisée et les deux systèmes peuvent cohabiter.
Cette modulation permet donc de faire évoluer le GPRS vers le EGPRS.
On utilise 6 débits de PCS-1 à PCS-6 variant de 22.8kbps à 69.2 kbps par TS. Le débit maximum instantané est donc de 553kbps.
La modulation 8-PSK n'est utilisée que pour les PDTCH (Packet Data Trafic Channel).
Architecture du réseau :
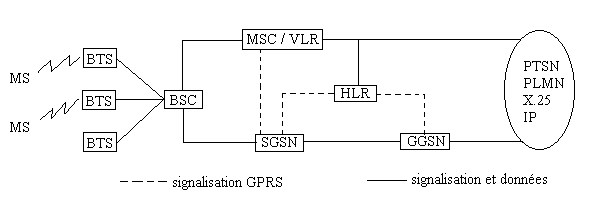
Suivant les conditions radios, on protège plus ou moins l'information en choisissant parmi 9 schémas de modulations et de codages (5 pour la 8-PSK et 4 pour la GMSK) qui sont découpés en trois familles. C'est à l'intérieur de ces familles que l'on pourra avoir un changement dynamique du schéma en fonction de l'évolution de la qualité du lien radio.
Réutilisation des fréquence de 1/3 et allocation des CCH (Control Channel) de façon à éviter émission et réception en même temps dans des cellules adjacentes. Cela nécessite donc une synchronisation entre BTS et cela implique la création de groupes de temps (4 groupes).
On a alors une réutilisation effective de 4/12 :
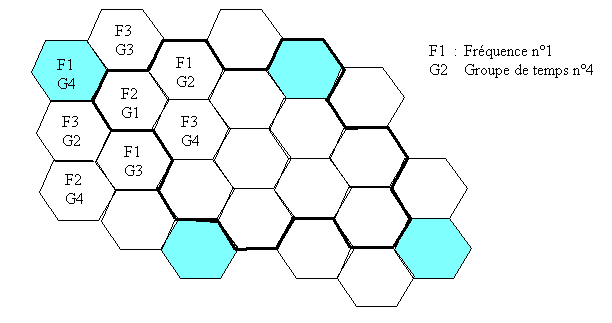
La tendance est ici de migrer de plus en plus vers des connexions paquets y compris pour la téléphonie. On arrive alors à des applications de voix sur IP, et de transport point à point de données multimédia sur IP.
La deuxième phase de GPRS supportera tous les services temps réel, elle est aussi appelée RT-EGPRS (Real Time EGPRS).
Cette étape est très proche de l'UMTS, on a la même gestion dynamique de la qualité de service et la possibilité d'utiliser plusieurs services en parallèle (ex: voix + consultation Web).
Les évolution du EGPRS porteront surtout sur l'utilisation de différentes profondeurs d'entrelacement, et de nouveaux codages dont les turbo-codes.
Le W-CDMA ou Wide-CDMA est une l'application large bande de la technique d'accès multiple par répartition de codes (les utilisateurs se différencient par leur code d'étalement). Il est fortement pressenti comme technique d'accès multiple pour les systèmes de troisième génération.
L’équation fondamentale du CDMA est :
R : débit
I : puissance équivalente des interférences
N : puissance équivalente du bruit thermique
L : affaiblissement du à la propagation
Ptx : puissance d’émission
Eb/N0 : rapport signal à bruit minimum requis
On en déduit que les interférences dépendent de la puissance de chacun des émetteurs présents et que la puissance à transmettre pour être " entendu ", dépend des interférences.
Ses principaux avantages sont :
Ses principaux inconvénients :
On peut définir un nombre maximum d'utilisateurs pour un rapport signal à bruit donné : le 'pole point'. Cette valeur dépend entre autre de la largeur de bande disponible et des interférences intra et inter-cellulaires.
On a aussi un changement important au niveau des interférences : dans un système standard, le signal désiré doit être au moins 18dB au dessus de tous bruits ou interférences, l'effet de cette observation est que l'on ne peut pas partager les mêmes portions du spectre dans des cellules adjacentes. Dans un système CDMA, les signaux peuvent être reçu malgré un haut niveau d'interférences. Dans les pires conditions, le signal peut être reçu avec la présence d'interférences 18dB au dessus du signal. Ainsi les mêmes fréquences peuvent être réutilisées dans des cellules adjacentes.
Système de troisième génération l'UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) devait théoriquement permettre différentes évolutions :
Actuellement, le système est en cours de normalisation, des problèmes apparaissent sur les bandes de fréquences disponibles, notamment aux USA. Le mode d'accès multiple choisit sera basé sur le W-CDMA même si certains organismes ont pensé à une évolution du TDMA.
Le principal inconvénient est l'importance des changements qu'il faudra apporter au réseau actuel. L'UMTS sera vraisemblablement déployé par plaques au dessus du réseau GSM pour des zones de forte demande. Il y aura alors des difficultés de roaming au moment de sortir de ces plaques.
L'UMTS devrait fournir des débits atteignant 2Mbps en indoor avec un débit chip de 3.84Mcps et des débits supérieurs entre 500kpbs et 1Mbps en outdoor.
Trafic et qualité de service
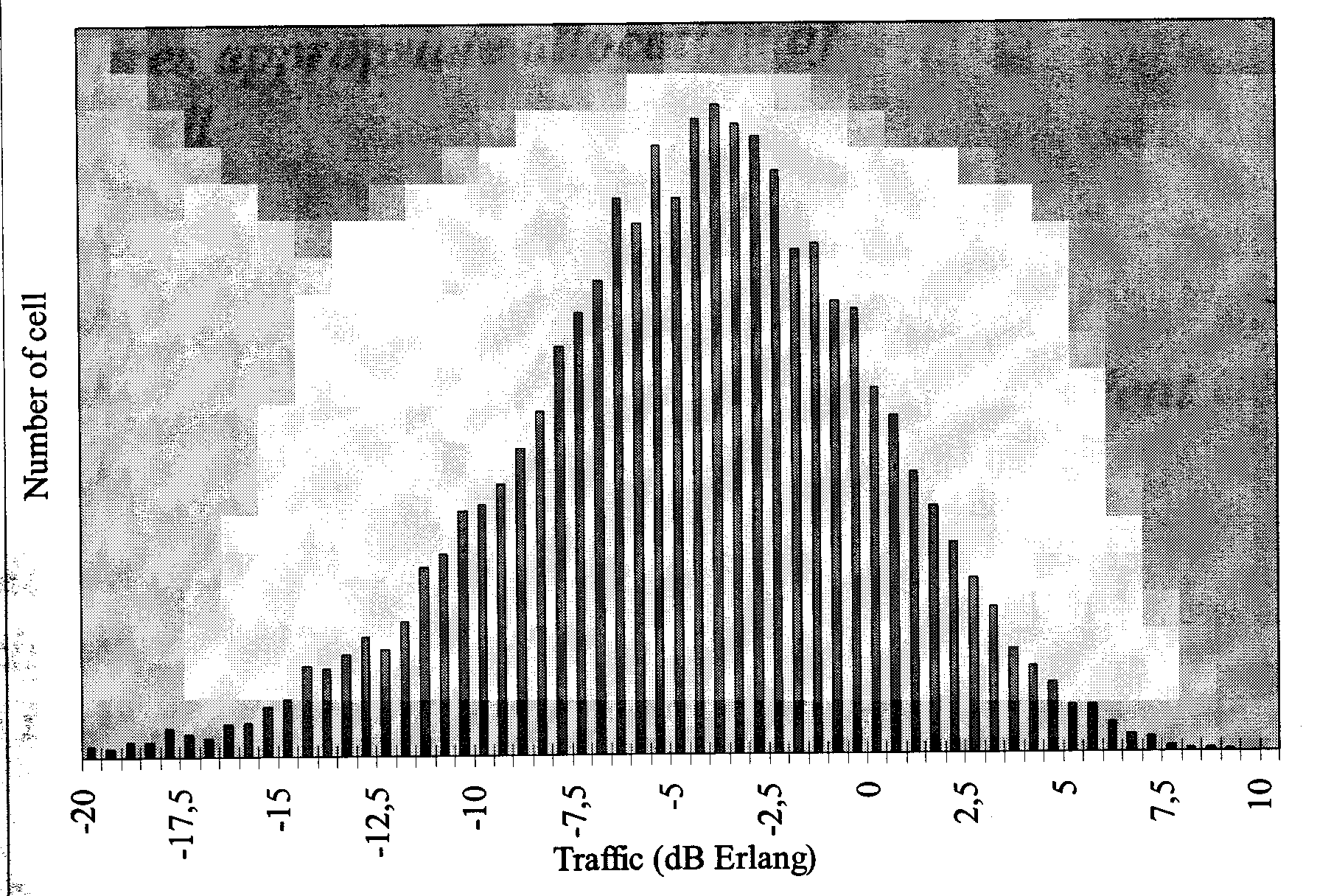 La
planification radio UMTS est dans un environnement multi-service
avec des distributions de trafic non homogène. En fait la
statistique spatiale du trafic cellulaire peut être représenté
par une distribution LogNormale :
La
planification radio UMTS est dans un environnement multi-service
avec des distributions de trafic non homogène. En fait la
statistique spatiale du trafic cellulaire peut être représenté
par une distribution LogNormale :
![]()
Système de deuxième génération : blocs de 200kHz
~40-150 canaux par opérateur disponibles
è si le trafic augmente, on ajoute des TRX
Système de troisième génération : blocs de 5MHz
~2-5 canaux par opérateur disponibles
è si le trafic augmente, on a besoin de nouveaux sites
Différents services et débits sont disponibles, on considerera que les besoins de base sont :
Pour la parole : BER = 10-3
8kbps
Pour les données en mode circuit : BER = 10-6 pour les Long Contraint Data (LCD)
64kbpss, 144kbps, 384kbps, 2048kbps
Pour les données en mode paquet : Uncontrained Delai Data (UDD)
Protection de type ARQ(*) è pas de BER
64kbpss, 144kbps, 384kbps, 2048kbps
(*) Si la donnée arrive avec une erreur on demande qu’elle soit renvoyée de nouveau
Si on rajoute à cela l’environnement, on peut déduire que la taille des cellules dépendra du service, du débit et de l’environnement :
| Service | Débit (kbps) | Environnement | Diamètre maximum |
| Parole | 8 |
Indoor | 902 |
| LCD | 64 |
Indoor | 648 |
| LCD | 2048 |
Indoor | 107 |
| UDD | 64 |
Indoor | 745 |
| UDD | 2048 |
Indoor | 317 |
| Parole | 8 |
Véhicule – 120km/h | 5967 |
Le spectre
La bande alloué de fréquences va dans un premier temps aboutir à une attribution de 155MHz (terrestre) et 60MHz (satellites) en 2005 puis un rajout de 185MHz (terrestre) et 30MHz (satellite) en 2010.
Recommandation Européenne pour l'attribution du spectre :
terrestre satellite terrestre terrestre satellite
TDD UL/DL |
FDD UL |
MSS UL |
TDD UL/DL |
FDD DL |
MSS DL |
1900 1920 1980 2010 2025 2110 2170 2200
TDD/FDD
Le FDD et le TDD sont les deux modes complémentaires de l'UMTS.
Le mode FDD prend en compte les trafics asymétriques en allouant un nombre de canaux différents pour les sens montant et descendant. Cette configuration est optimisée pour des rapports d'asymétrie de l'ordre de 1.5 (rapport entre le nombre de fréquences dans les sens descendant et montant), une des directions est sous-utilisée lorsque cette condition n'est pas remplie, ce qui se traduit par une baisse de l'efficacité spectrale. Cette approche peut libérer un certain nombre de canaux de 5MHz, notamment dans la bande allouée au trafic montant pour le cas le plus largement envisagé de trafic dominant dans le sens descendant. Des canaux TDD peuvent dans ce cas y être placés afin d'améliorer l'efficacité spectrale.
Le mode TDD supporte l'asymétrie au niveau de chaque canal en allouant un nombre d'intervalles de temps proportionnel à la quantité de trafic dans les sens montant et descendant. Le mode TDD permet une optimisation de l'efficacité spectrale en présence de trafic asymétrique, notamment aux rapports d'asymétrie pour lesquels une partie des fréquences FDD peut être libérée dans le sens montant.
Il y a plusieurs scénarios pour l'utilisation du spectre non appairé :
Rq : le TDD implique un accès multiple mixte (trame GSM +
étalement), on doit alors savoir qui transmet et quand, sous
réserve d'avoir de gros problèmes d'interférences ![]() synchronisation inter
BTS (pas nécessaire en FDD)
synchronisation inter
BTS (pas nécessaire en FDD)
En conclusion sur ces deux modes :

Affectation des cellules en fontion du mode choisit
Cellule macro FDD : couverture vaste
mobiles à grande mobilité
Cellules micro FDD : utilisé au niveau piéton
outdoor
donne un surplus de capacité
Cellules pico TDD/FDD : déployé principalement en indoor
permet des services à débits importants
la portée est le facteur limitant
Affectation du spectre par opérateur
A l'ouverture du service chaque opérateur devra avoir un minimum de 2 x 20MHz en FDD attribué (2 x 15 au minimum). Ces bandes permettront le déploiement d’une structure cellulaire hiérarchique complète où la demande en trafic est importante. Une bande de 10MHz (5 au minimum) en TDD permettra d’augmenter la capacité pour des applications de faible mobilité, typiquement en indoor.
Au niveau mondial, les bandes utilisées devraient être sensiblement les mêmes afin de réaliser un réseau mondial cohérent. Le principal problème vient des 2tats Unis ou le spectre est déjà occupé par le réseau PCS 1900. Les Américains sont en train de réfléchir comment libérer de la place :

Qualités de services - modulations
L'UMTS gérera différentes qualités de services en parallèle et de façon dynamique, en utilisant un facteur d'étalement variable (entre 4 et 256). Les services à débits variables seront de type RT (Real Time Transparent) ou NRT (Non Real Time Transparent).
La signalisation devrait évoluer vers un système basé sur le protocole IP.
La modulation utilisé est de type QPSK, l'espacement entre porteuse de 5MHz en restant multiple de 200kHz pour pouvoir rester compatible avec le GSM. Les trames devrait comporter 15 slots et durer 10ms.
Autres changements
Un autre changement important est la gestion des handovers qui sera de type soft handover, le mobile déclenchant le transfert de connexion en deux étapes : connexion à une BTS de puissance plus élevée, puis une fois que la connexion est bien établie, séparation avec la BTS précédente.
Le fait que plusieurs BTS puissent gérer un même mobile va être utilisé pour utiliser une technique de macro diversité, on obtient ainsi un gain en stabilité :
Stratégie de migration vers l’UMTS
Migration 1G/2G
Le GSM est un système de deuxième génération, ce qui implique que la téléphoie mobile a déjà connu une migration : celle qui a mené le système 1G (Radiocom 2000) vers son successeur.
Radiocom 2000 n'était pas un système orienté vers le marché de masse. Le prix des mobiles, celui des communications et sa capacité de fait limité par le spectre en faisait un produit limité aux utilisations professionnelles (et plus encore aux sphères dirigeantes des entreprises). Néanmoins, sa couverture quasi globale du territoire (et non de la population) en faisait le système mobile par excellence.
Les systèmes de première génération ne connaissaient pas encore la déréglementation des télécommunications et évoluaient donc dans un environnement économique protégé.
Enfin, le grand marché du GSM comme celui de Radiocom était la voix ... Bien évidemment, le GSM a apporté le handover ainsi que la compacité et la légèreté des terminaux, mais les concepts d'infocom (avec l'accès au monde IP) et de convergence étaient encore bien lointains au début des années quatre-vingt dix.
L'introduction de la 2G sur la 1G s'est déroulée sans migration effective que ce soit pour les utilisateurs finaux (pas de terminaux bi-mode) ou pour les opérateurs (pas d'équipement bi-standard).
La 2G avant la migration
Le GSM est maintenant un marché de masse qui connaît une concurrence rude avec souvent plus de deux opérateurs mobiles par pays, et des clients difficiles à fidéliser. Pour cela les investissements sont importants dans tous les domaines, infrastructure, services, marketing... Ceci conduit à des politiques de différenciation d'offre et de segmentation de marché selon le choix de l'opérateur dictées par sa stratégie, son histoire... et ses capacités financières à déployer un réseau mobile.
Migration vers la 3G
Nul doute que le scénario 1G/2G ne pourra se reproduire. Il reste donc à étudier les différents problèmes liés à l'introduction d'un système mobile dans un marché mature mais encore en évolution et en forte expansion.
A défaut d'avoir une vue précise du monde des opérateurs mobiles lors de l'introduction de l'UMTS, nous avons aujourd'hui l'avis de certains opérateurs 2G.
Les principales requêtes des opérateurs existant sont:
- Préserver l'investissement fait en 2G
- Assurer une compatibilité ascendante
- Pouvoir différencier son offre
L'introduction de l'UMTS s'effectuera sur un marché mobile en expansion qui nécessitera certainement des investissement parallèles dans des infrastructures 2G pour en augmenter la capacité. Compte tenu des délais d'amortissement, il est évident que l’introduction de l'UMTS ne peut ignorer ce fait, et doit donc s'effectuer "sans occulter" la 2G.
La compatibilité ascendante est aussi liée à ce facteur. Elle permet de répondre à l'augmentation de trafic qu'il provienne de système 3G ou 2G. Bien évidemment, des contraintes technologiques empêchent cette compatibilité pour certains équipements, en particulier pour le système d'accès radio.
Les contraintes des opérateurs 2G en terme de sauvegarde d'investissement et de compatibilité ascendante et celles des utilisateurs en terme de couverture sont heureusement convergentes: en continuant d'assurer une couverture nationale par la 2G et donc d'utiliser et d'amortir leurs infrastructures, les opérateurs offrent un service non dégradé et plus riche. De plus, ils se "défendent" face à d'éventuels nouveaux venus UMTS (donc à couverture radio restreinte) en profitant de leurs acquis.
Principaux scénarios de déploiement
On peut maintenant classer les scénarios de déploiements en trois grandes catégories:
- Evolution de 2G en 3G
- Start-up 3G
- Evolution de fixe en 3G
C'est le scénario "naturel" à condition que l'opérateur 2G réussisse à obtenir une licence UMTS ...
Il est clair que la différence technologique entre l'accès GSM et l'accès UMTS (due principalement à l'introduction du CDMA et de l'ATM) conduit à une différence significative des équipements d'accès radio. Les sites de station de base pourront certes être réutilisées dans la mesure de l'espace disponible. Des antennes bi- modes GSM/UMTS pourraient certainement être déployées, mais les deux systèmes resteront bien distincts.
En revanche, les parties GSM NSS et UMTS CN (Core Network) pourront offrir une certaine compatibilité avec la possibilité d'intégrer des éléments 2G et 3G dans le même réseau et de partager certaines fonctions. Cela permettra par exemple de faciliter l'intégration du réseau complet de l'opérateur et de baisser les coûts d'exploitation.
C'est le cas d'un opérateur "seulement UMTS" ou de celui d'un opérateur "mixte" souhaitant complètement séparer les deux entités GSM et UMTS.
L'interconnexion entre les deux systèmes ne se fera que par "roaming".
Un opérateur fixe obtenant une licence UMTS peut essayer de profiter de son marché "domestique" en déployant son service mobile avec pour cible la convergence fixe/mobile par le biais de Home Base Station par exemple. Il peut aussi attaquer le marché de la couverture professionnelle (multi-sites industriels ... ).
Ce scénario est d'autant plus valide que des accords avec des opérateurs nationaux existent.
Les îlots UMTS
Quelque soit le scénario, les contraintes mêmes du déploiement d'un système mobile amènent à la notion "d'îlots", au moins pendant les premières années d'exploitation.
Les mobiles pourront naviguer entre ces deux systèmes (UMTS et GSM ou GPRS) avec une continuité parfaite de service pour la voix, et en ce qui concerne les data, une offre de service "riche" dans les îlots UMTS et une plus restreinte dans le reste du réseau grâce au GPRS. Des handovers " sans couture " entre les deux systèmes seront possibles pour la voix et les services data sauf pour ces derniers lorsqu’ils nécessiteront des capacités propres à l’UMTS. Dans ce cas, ils seront limités à la zone de couverture 3G.
La couverture GSM traditionnelle va s’améliorer en terme de surface couverte et va se densifier.
La couverture GPRS va apparaître en îlots puis se densifiera petit à petit, pouvant recouvrir la totalité du réseau GSM.
Plusieurs voies pourront alors être suivies :
Les opérateurs GSM qui auront décidé de ne pas investir dans la nouvelle interface radio UMTS, pourront, avec EDGE, proposer un accès données haut débit, aux utilisateurs. Les débits de 384kbps/s étant possibles dans de bonne conditions radio, l’introduction de EDGE demandera une densification des stations de base afin d’obtenir une meilleure continuité de service haut débit.
Les opérateurs GSM ayant obtenu une licence UMTS proposeront dans un premier temps, des îlots UMTS aux utilisateurs. Puis ces îlots enfleront petit à petit.
De nouveaux utilisateurs pourront proposer directement et uniquement un accès UMTS. Ceci sera une opportunité de se lancer dans la troisième génération. A l’aide d’accords de roaming avec des opérateurs GSM, ces nouveaux acteurs pourront offrir une couverture globale GSM/UMTS.
La décision d’orientation vers l’UMTS prendra en compte le fait que l’interface WCDMA est conçue pour donner accès aux services orientés paquet sur laquelle la voix peut aussi être transportée. Elle est mieux adaptée aux débits rapidement variables et aux traitement simultané de plusieurs utilisateurs utilisant différents services en parallèle.
Rayons de cellules
Les perturbateurs reçus à la station de base vis à vis d'un mobile donné sont :
• les interférences venues des autres mobiles contrôlés par la cellule (interférence intra cellulaire),
• les interférences venues des mobiles sous contrôle d'autres cellules de l'opérateur (interférence extra cellulaire),
• les sources de bruit extérieur au système (bruit thermique, interférence des réseaux situés dans les bandes adjacentes, etc ... ).
Pour une charge de cellule donnée, la somme de ces interférences va fixer un plancher de bruit, qui compte tenu de la limite de puissance des mobiles, va induire une limite du rayon de cellule afin de pouvoir obtenir le rapport signal à bruit requis au niveau de la station de base.
Au niveau de l'ingénierie :
Comparaison simplifiée entre planification GSM et UMTS :
Processus ‘step by step’ Processus ‘all in one’
On voie que si l’élaboration d’un réseau cellulaire de deuxième génération est séquentielle, celle réseau de type UMTS devra être faite en considérant tous les paramètres en même temps, ces paramètres étant fortement liés.
GSM
GPRS
EGPRS
UMTS
Connexion Circuit Circuit + paquet Circuit + paquet Paquet principalement Accès multiple TDMA Idem GSM Idem GSM W-CDMA (?TD-CDMA?)
Modulation GMSK GMSK 8-PSK et GMSK QPSK Spectre 2 x 35MHz autour de 920MHz 2 x 75MHz autour de 1800MHz
Idem GSM Idem GSM 155MHz + 60MHz autour de 2050MHZ en 2005 +185MHz +30MHz en 2010
Duplex 45MHz en GSM 900 95MHz en DCS 1800
Idem GSM Idem GSM 190MHz pour la bande appairée Largeur canal 5MHz Espacement entre porteuses 200kHz Idem GSM Idem GSM Multiple de 200kHz Longueur trame 8 x 148 bits Idem GSM Idem GSM 15 x 96bits ? Durée trame 4.615ms Idem GSM Idem GSM 10ms Nombre de slots par trame 8 8 8 15 Utilisation multislots Non Oui Oui Oui Services T et NT T et NT RT et NRT RT et NRT Voix, SMS, Fax OK OK OK OK Accès Internet Limité Correct Complet Complet Vidéo Non Limité Correct - bon Complet Débits De 300bps à 9.6kbps De 9.05kbps à 21.4kbps par TS
jusqu'à 171kbps
De 22.8kbps à 69.2kbps par TS
jusqu'à 553kbps
Jusqu'à 2Mbps en indoor Débits variables dynamiquement Non Non Oui Oui QoS variable dynamiquement Non Non (négociée appel par appel) Oui Oui Multiservice Non Non Oui Oui Disponibilité Depuis 1992 Mi 2000 2001? 2002 ? Signalisation SS7 Idem GSM Idem GSM Système basé sur IP Architecture (par rapport au GSM) Légers changements : GGSN, SGSN, reprogrammation BTS Idem GPRS Nouvelle architecture Particularités pour le déploiement (par rapport au GSM) Influence sur le trafic lié à l'utilisation de plusieurs slots simultanément Idem GPRS Gestion des flux d'abonnés Contrôle de puissance
Multi-service
Macro diversité